
 |
P r o p h e t i e s O n L i n e |
|
|
The largest library about Nostradamus for free ! |
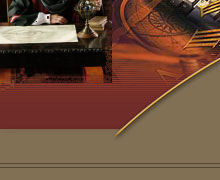
| Researches 191-200 |
| 191 - Rabelais et Nostradamus faiseurs d’almanachs |
| 192 - L’attirance pour l’inconsistance : l’exemple des Centuries et du thème natal |
| 193 - Nostradamus : la biographie à la merci de la bibliographie |
| 194 - Les Centuries, entreprise inachevée ou tronquée. |
| 195 - Nostradamus et Morin de Villefranche : le vivant et le posthume |
| 196 - Les Centuries, comme œuvre d’un poète inconnu |
| 197 - Les centuries comme métamorphose du discours nostradamien |
 |
Researches 191-200
|
191 -
Rabelais et Nostradamus faiseurs d’almanachs Par Jacques Halbronn On connait une « Grande et vraye Pronostication nouvelle pour l’an 1544 » de Rabelais alias Seraphino Calbarsy (anagramme), reprise dans le volume de La Pléiade, sur Rabelais (pp. 951 et seq) que l’on peut rapprocher de la production parue sous un titre assez proche sous le nom de Nostradamus, au cours de la décennie suivante. Le lecteur de l’Epître à Henri II est frappé par un passage de cette publication rabelaisienne : « En laquelle Saturne depuis le premier de mars iusques au XX. de juillet parfera sa retrogradation, Iupiter dès le VII mars au VI juillet sera molesté de rétrogradation . Mars dès le XXII may jusques au XXVI juillet retrogradera. Vénus dès le commencement de l’année iusques au XIV de janvier sera rétrograde. Mercure depuis le XXVI de mars iusques au XVII d’avril et dès le XX juillet et jusques au XII d’aoust et oultre ce depuis le XIV novembre jusques au IIII décembre il retrocedera » Dans la Pantagruéline pronostication, au chapitre de l’éclipse de l’année, il est fait une bréve référence au fait que telle planéte puisse être « rétrograde », « directe » ou « inconstante ». On sait toute l’importance que Nostradamus accordait aux éclipses à la fin de sa vie. Epitre à Henri II « depuis le temps que Saturne qui tournera entrer à sept du moys d’Avril iusques au 25. D’Aoust Iupiter à 14. De Iuin iusques au 17. D’Octobre etc » On notera un probléme de ponctuation. Il y aurait du y avoir une virgule entre les positions de Saturne et celles de Jupiter. Cette faute trahit le peu de soin du travail de « saisie » et de compréhension du texte par le compilateur. On sait que ces positions concernent l’an 1606 mais cela n’est même pas indiqué explicitement. Il reste que ce type de développement sur les rétrogradations correspond à la pratique des Pronostications. Toutefois, l’on ne retrouve pas un tel exposé systématique dans les exemplaires qui nous sont parvenus des Pronostications de Nostradamus (pour 1557 et 1558). L’on peut donc se demander si les compilateurs de l’Epitre à Henri II ne se sont pas servis de publications relativement anciennes antérieures à la période de production de Nostradamus. Dans quelle mesure la Pantagruéline Pronostication se calque sur les Pronostications « normales » de Rabelais ? On y trouve un chapitre sur les Eclipses dans les deux cas mais dans la Pantagruéline pronostication, on ne trouve pas de données astronomiques précises. On a gardé le cadre mais vidé en partie le contenu de sa substance, quand bien même une année précise serait donnée qui favorise la mépris L’exemplaire de la BNF pY2 21 donne le titre suivant pour la Pantagruéline Pronostication : (p. 225) : « Pour l’An Mil cinq cens quarante & sept »/ Par la suite, la formule sera « pour l’an perpétuel » Il est étonnant que la forme « 1547 » soit signée François Rabelais alors que la forme « perpétuel » est signée « Maistre Alcofribas architriclin dudict Pantagruel » On aura abandonné la forme »An perpétuel » pour donner une échéance précise mais par la suite on reviendra à la formule « An perpétuel » et à Alcofribas, anagramme. Cette variante « 1547 » n’est pas signalée dans le volume de la Pléiade (notes de François Moreau, pp. 1703-1704) qui ne dépasse pas les années 1530. Or, en 1547, le titre de la Pantagruéline Pronostication ne reprend pas la formul de l’An Perpétuel mais renoue avec la fixation d’une année correspondant à la date de parution de l’ensemble du recueil. ». Cette mention de 1547 pour la Pantagruéline Pronostication, non signalée par les spécialistes de Rabelais renforce les particularités de cette édition (dont la BNF a un exemplaire), dont notamment le « Prologue Pantagruel » qui ne sera pas repris à la veille de la mort de Rabelais. Les éditions des années 1550 reprendront la forme « An perpétuel ». Rappelons à ce propos que dans la Préface à César, il est fait référence à de « perpétuelles vaticinations ».. On notera que simultanément Rabelais publie d’une part une Pantagruéline Pronostication pour 1547 sous le nom de François Rabelais, au sein d’un ensemble de quatre « livres » et une vraie Pronostication sous le pseudonyme de Seraphino Calbarsy. On notera la similitude des titres pour Calbarsy et pour Nostradamus : La grand pronostication nouvelle avec portenteuse prédiction pour l’an MDLVII composée par Maistre Michel de nostre Dame, Docteur en Medecine de Salon de Craux en Provence. On connait une précédente édition (cf Pléiade pp. 945 et seq) pour 1541 dont le prologue est identique mais les calculs différents. Nostradamus évitera, en revanche, de se répéter d’une année sur l’autre . Au lecteur bénivole. Salut et paix en Iésus le Christ (formule reprise dans la Pantagruéline Pronostication) : « En ce peu de papier qu’il restoit blanc, je respondroys voluntiers à la calumnie d’aucuns ocieux. (..) Laissant doncques telles resveries, je me convertis à brievement vous exposer ce que je trouve de ceste presente année », On notera ce point commun entre Rabelais et Nostradamus faisant référence à la calomnie. Il y a dans les Significations de l’Eclipse de 1559 « avec une sommaire responce à ses dettracteurs »– et qui comporte exceptionnellement la vignette des Pronostications- qui selon nous est une contrefaçon, un développement assez rabelaisien : (cf ed . Chevignard, Présages de Nostradamus, Paris, Seuil, 1999 ; pp. 465 et seq) « ce gros animal est si téméraire & si hébété d’entendement de se dire Philosophe (..) Quelle cause te vient esmouvoir de calumnier celuy qui ne fait ne dict mal à personne » Un autre passage est quasiment identique entre la version pour 1541 et celle pour 1544 « De la disposition des biens et fruictz de la terre » Selon les influences célestes, je trouve que nous aurons bonne année de touz biens et fruictz provenant de la terre, mesmement de grain, de foin, lesgumages et cultivages. Lesquels seront bien dangereux d’estre gastez à caus de grand vermine que la terre produyr a ceste année » (p 946) Le texte pour 1544 varie à la fin : » « dangereux d’estre gastez à cause des planétes dessusdictes qui regneront cette année », ce qui nous semble plus approprié. On dispose de deux publications annuelles pour 1541(reprises in Volume Pléiade, pp . 941 et seq). Etrangement, l’almanach pour 1541 est signa François Rabelais alors que la pronostication est signée Seraphino Calbarsy comme s’il était plus honorable de signer un almanac h qui n’est qu’un calendreir qu’une pronostication plus marquée par l’astrologie. Or nous avons observé que tantôt la Pantagruéline pronostication est signée Alcofribas et tantôt Rabelais. Les almanachs de Rabelais pour les années 1533 et 1535 sont bel et bien signés Rabelais. A la différence des Pronostications, Rabelais présente des propos introductifs différemment rédigés. On notera que chez Nostradamus, les vignettes sont réservées aux seules pronostications, du moins au cours des années 1550, la présentation des almanachs étant plus sobre (cf notammment le triptyque de 1557 (dans notre édition de 2002, Ed. Ramkat). On trouve dans un coin de la vignette la forme » M. de Nostredame », au sein d’un blason. Rappelons que la vignette de la Pronostication chez Nostradamus est à rapprocher de celle de la Pantagruéline Pronostication pour 153 7 (BNF Réserve, pY2 164), vignette qui représente l’auteur et que l’on retrouve à diverses occasions, comme à propos de « la généalogie et antiquité de Gargantua ». ou encore, comme déjà signalé ailleurs, du « Prologue Pantagruel » du Quart Livre, dans l’édition de 1547, texte qui ne sera pas repris par la suite. JHB 06. 05. 13 |
|
192 -
L’attirance pour l’inconsistance : l’exemple des Centuries et du thème
natal Par Jacques Halbronn Parfois, l’on nous demande : mais qu’est ce qui a fait le succès des Centuries de Nostradamus ? En fait, il vaudrait mieux se poser la question suivante : pourquoi de toute l’œuvre de Nostradamus n’a-t-on retenu que les Centuries mais pour s’interroger ainsi encore faut-il savoir que Nostradamus n’est pas l’auteur des seules Centuries. La même question peut se poser à propos de l’astrologie : pourquoi est-ce cette partie de l’astrologie qui occupe l’essentiel du terrain et point d’autres parties ? Mais là encore faut-il avoir une vision globale de l’Astrologie, ce qui n’est pas donné à tout le monde. En fait, ce qui aura surnagé tant au regard de Nostradamus que de l’Astrologie semble concerner les productions les plus touffues, les plus inconsistantes donc les moins « falsifiables » (Popper). Dans le cas de Nostradamus, on le sait à présent, les centuries sont très vraisemblablement un recyclage posthume de ses brouillons, de ses notes éparses, un peu comme pour le Cinquième Livre de Gargantua et Rabelais, pour ne pas parler des Pensées de Pascal. Dans le cas du thème natal, le mode d’emploi en est aussi souple que celui des quatrains. Comme dirait Darwin, ce qui est conservé est ce qui aura le mieux résisté. En fait, à partir du moment où un texte connait une certaine fortune, il s’enrichit de commentaires, d’applications et donc se renforce, se consolide s’impose. Autrement dit, ce sont les éléments les plus inconsistants qui surnagent, qui survivent à la postérité ou plutôt, la postérité conserve le pire et le meilleur, le plus « mou » et le plus « dur ». Cela signifie qu’au sein de chaque domaine, il y aura une sorte de guerre intestine entre les « survivants » et que ce n’est pas forcément le plus valable qui l’emporte. Dans nos travaux sur ces deux questions, nous avons clairement montré à quel point cette dualité pouvait exister et résister. En astrologie, on a en effet d’une part le thème astral qui est un salmigondis de données éparses que l’on cherche à unifier mais qui change d’un cas sur l’autre, on pourrait dire d’un instant à l’autre face à n cycle universel qui intègre les principes mêmes de l’ordre socio-historique et d’autre part, on a les centuries qui n’ont d’ailleurs rien d’astrologique face à une œuvre astrologique du dit Nostradamus qui .s’inscrit dans le droit fil d’une quête d’une astrologie s’articulant sur un nombre limité de données, et notamment sur les éclipses, un aspect de son œuvre totalement inconnu du public et qui aura d’ailleurs connu des applications plus ou moins heureuses du fait même de leur précision , Ce qui nous renvoie à un problème de méthodologie et à la maladie infantile de l’astrologie, à savoir q qu’il ne faut pas chercher à être précis dans les détails mais juste dans les grandes lignes. C’est là une quadrature du cercle à laquelle se heurtent la plupart des astrologues et qu’ils gèrent diversement. L’astrologie ne peut se passer, selon nous, d’une certaine dose d’abstraction dans ses formulations et elle doit également « nettoyer » son objet d’étude. On ne théorise pas sur des assiettes sales quand on veut élaborer l’idée d’assiette. Trop d’astrologues, à la façon des médecins d’autrefois qui ne se lavaient pas les mains avant d’opérer, ne prennent même pas la peine de toiletter les données qu’ils entendent analyser, ce qui les condamne à l’échec. Mais parfois, cette négligence leur apporte un semblant de succès. Que dire si l’on place dans le même ensemble des produits différents mais qui ont été exposés à un même ingrédient, ce qui leur donne un même aspect, un même « goût » ? On ne cessera donc de le répéter : l’utilisateur d’un modèle astrologique doit « laver » son objet, doit le réduite, le décanter. C’est là une opération préalable. Et inversement, toute prévision astrologique devra être ajustée à un contexte et ne pas se présenter dans sa nudité. Nous suggérons que chacun s’applique à lui-même le dit modèle plutôt qu’il ne l’applique à un tiers. Car applique le modèle astrologique à un inconnu, c’est basculer dans la divination, c’est outrepasser les limites de l’astrologie et c’est finalement aboutir à une astrologie boursouflée. Ce qui signifie qu’avant d’appliquer un quelconque modèle astrologique, il importe de le nettoyer, de l’aseptiser, de le délester de ses souillures, le rendre à sa virginité. Trop souvent, la propreté extérieure d’une personne, d’un lieu masque la saleté et le désordre intérieurs si ce n’est que d’aucuns nous disent que le thème natal nous décrit cet intérieur tel qu’il est. En aucune façon, pensons-nous l’astrologie n’est responsable de la souillure, de la pollution, du monde et c’’est un scandale que de sanctuariser ce qui est dévoyé.. Selon nous, les centuries défigurent Nostradamus tout comme le thème natal est une énorme verrue sur le nez de l’astrologie. JHB 10. 05.13 |
|
193 -
Nostradamus : la biographie à la merci de la bibliographie Par Jacques Halbronn
|
|
194 - Les
Centuries, entreprise inachevée ou tronquée. Par Jacques Halbronn Si nous avons concédé que les centuries pouvaient reprendre certains textes en prose – le cas « macelin » témoigne du recours à l’appendice de l’almanach pour 1562- il est deux points qui ne sauraient pour autant être admis : d’une part, en ce qui concerne la mise en vers de la prose de Nostradamus et d’autre part en ce qui concerne les éditions censées parues du vivant de Nostradamus. Sur le premier point, il nous semble tout à fait hors de question que Nostradamus ait lui-même versifié ses notes manuscrites d’autant que selon nous les quatrains des almanachs (par la suite désignés, au XVIIe siècle, sous le nom de présages) obéissent au même schéma de versification par un tiers de la prose. Sur le second point, la thèse des brouillons retrouvés à la mort de Nostradamus exclue d’emblée toute publication des Centuries avant son décès. Ce qui est une vérité de La Palisse. Les historiens de l’Art ont l’habitude de débattre de l’authenticité de telle ou telle œuvre. Ils admettent volontiers que tel auteur ait des collaborateurs. C’est ainsi que nous lisons dans une « Histoire de la Peinture », que « Rembrandt compte de nombreux imitateurs. Ils reproduisent si fidèlement son style qu’il est quasiment impossible de distinguer leurs œuvres des siennes. Cette incertitude fait l’objet de nombreuses recherches » (Collectif, Ed France Loisirs, p. 246, 2008) On se souvient de tel nostradamologue qui déclarait « inimitable » le style de Nostradamus pour évacuer la thèse selon laquelle il ne serait pas l’auteur des Centuries. Position d’autant plus intenable qu’elle prenait pour référence les « présages » dont l’attribution à Nostradamus est bien improbable. La forme versifiée est aux antipodes de la démarche de Nostradamus qui voulait que son lecteur suivît de près son argumentation, sans se dissimuler derrière une esthétique baroque et contournée.. La recherche nostradamologique ne saurait se réduire à recopier les dates figurant sur les pages de titre des éditions, ce dont se contentent le plus souvent les bibliothécaires. Il importe de respecter une vraisemblance, une logique, un contexte. Dater une pièce non datée ou antidatée n’est évidemment point chose simple et accessible au premier venu et si certaines contrefaçons grossières ont pu être démasquées, comme les éditions Pierre Rigaud 1566 parues, hors du royaume, à Avignon au XVIIIe siècle, d’autres ont échappé à la critique dès lors qu’elles respectaient une certaine façade, comme Macé Bonhomme, Lyon, 1555 dont on nous dit que ces éditions sont « conformes » à certaines pratiques du dit Bonhomme, comme s’il était si difficile que cela de récupérer certains éléments anciens, d’une génération à l’autre. Plus l’on est savant et plus il est loisible de contrefaire les choses. Le recoupement par le jeu des traductions nous semble assez concluant et force est de constater que si certaines publications de Nostradamus se retrouvent au XVIe siècle en italien, en allemand, en flamand ou en anglais, il n’y a point, à l’époque, trace des centuries, dans une langue étrangère, alors même que certains quatrains-présages sont traduits, Ce n’est qu’en 1594 que le Janus Gallicus offre une traduction partielle latine à la fois des quatrains-présages et des quatrains centuriques. Le bilan des témoignages de quatrains centuriques parus du vivant de Nostradamus ou même avant les années 1580, est terriblement maigre et ce d’autant plus que nous avions mis au défi les chercheurs, voilà près d’une vingtaine d’années de nous en fournir des preuves. En fait, c’est nous qui avons signalé certains cas allant dans ce sens et notre exposé de soutenance en 2008, à la Sorbonne, en postdoctorat (cf sur teleprovidence), avait été centré sur l’Epitre de Jean de Chevigny à Larcher, en tête de la traduction de l’Androgyn de Dorat (1570, Bib, Arsenal), dans laquelle épitre figurait un quatrain dument numéroté. De même avions nous signalé l’usage ponctuel du mot Centurie dans les Significations de l’Eclipse de 1559. Et bien entendu, il y a le cas Antoine Crespin, certaines de ses œuvres fourmillant de versets centuriques, au début des années 1570 (cf notre édition, Ramkat, 2002). En fait, nous sommes tellement habitués à associer le mot Centurie au mot prophétie que l’on oublie que ce terme était purement technique et consistait à faciliter la recherche d’un passage précis, grâce à une table des matières comportant la liste de chaque verset, comme on peut le voir dans le Janus Gallicus. La méthode centurique sert au classement et permet de retrouver rapidement ce que l’on cherche. Il est d’autant plus étonnant qu’un tel index ne figure pas dans les éditions de la Ligue alors même que le dispositif centurique est en place, comme si l’entreprise n’avait pu être menée à son terme. Les Centuries ne seraient-elles point une œuvre inachevée ?. Une telle hypothèse militerait paradoxalement en faveur d’un projet propre à Nostradamus lequel aurait esquissé un travail qui n’aurait pu aboutir mais dont le plan était plus ou moins tracé. Une autre hypothèse, à laquelle nous tendons actuellement à souscrire, serait qu’il y aurait bien eu une première édition centurique posthume mais que l’on n’en connaitrait que des moutures tronquées, parues en l’état faute de mieux. L’absence de mode d’emploi milite dans ce sens. Une telle carence, on l’a dit, sera réparée partiellement dans le Janus Gallicus mais l’on peut aussi se demander si ce commentaire n’est pas inspiré d’une première édition centurique perdue. On comprendrait ainsi la présence du quatrain VI, 100 dans le Janus Gallicus alors qu’elle ne figure dans aucune édition centurique du XVIe siècle. On sait que d’aucuns ont tenté de masquer l’absence de ce quatrain en laissant croire que le quatrain latin jouait ce rôle (Legis cautio) alors que le dit quatrain latin témoigne d’une édition se terminant justement à la fin de la Vie centurie et qui n’a pas été retrouvée. Le même Janus Gallicus fournit des commentaires des quatrains qui manquent totalement dans les éditions centuriques censées parues dans la seconde moitié du XVIe siècle. Nous proposons donc le point de vue suivant : il a été perdu une première édition posthume des « Centuries » comportant un commentaire et un index des versets. Cette édition était connue de ceux qui ont mis en place le Janus Gallicus. Pour quelque raison, on ne disposerait que d’éditions « pirates » très incomplètes de la dite édition. Ceux qui achetèrent ces éditions furent trompés sur la marchandise. Mais on peut penser que la vente des dites éditions n’était pas liée à un commentaire des centuries mais bien à certains quatrains complaisamment ajoutés ou retouchés dont le public était averti par la rumeur comme il le sera sous la Révolution.(cf notre étude sur la fortune du Mirabilis Liber à cette époque) JHB 21. 05.13 |
|
195 -
Nostradamus et Morin de Villefranche : le vivant et le posthume Par Jacques Halbronn Dès le début des années soixante-dix, nous avions été confrontés à cette problématique des publications posthumes, lesquelles se situent au cœur du débat nostradamologique. En découvrant à la Bibliothèque de l’Arsenal les Remarques Astrologiques de Jean-Baptiste Morin connu au XXe siècle sous le nom de « Morin de Villefranche », ce fut un choc (dont je m’entretins avec André Barbault). Choc en effet de pouvoir lire Morin écrivant en français alors que l’on ne nous présentait que des traductions (partielles) du latin (Selva, Hiéroz). En 1975, nous publiâmes dans la Bibliotheca Hermetica, dirigée par René Alleau, l’ouvrage en question.(Ed Retz), ce fut notre premier livre paru. Or, avec le recul, nous percevons comme un signe avant-coureur de nos travaux sur Nostradamus, engagés à la fin des années 80, à savoir la problématique des parutions posthumes en dialectique avec les parutions du vivant de l’auteur. En effet, les Remarques Astrologiques sur le Centiloque, dont Nicolas Bourdin avait donné peu avant un commentaire, (cf notre postface à l’édition du dit ouvrage de Bourdin, Paris La Grande Conjonction-Trédaniel, 1993), se référaient à un ouvrage qui n’était pas encore paru, à savoir l’Astrologia Gallica, ouvrage qui parut en 1661, quelques années après la mort de Morin.. Morin n’avait d’ailleurs décidé de faire paraitre quelques éléments de son magnum opus qu’en raison de sa polémique avec le dit Bourdin, marquis de Vilennes. Et les morinologues n’avaient pas accordé d’intérêt à ces Remarques. Si l’on en revient à Nostradamus, il est clair que celui-ci n’avait pas tout publié de son vivant, comme semble en témoigner son testament de 1566 qui se soucie de ce qui adviendra de ce qu’il laisse derrière lui. Si l’on prend les Significations de l’éclipse de 1559, on note qu’il y est fait référence à une « seconde centurie ». : « comme plus amplement est déclaré à l’interprétation de la seconde centurie de mes prophéties » (fol B II, fac simile Chevignard, Présages de Nostradamus, Seuil, 1999, p. 455). On songe à Morin annonçant dans ses Remarques qu’il traitera de tel point dans son Astrologia Gallica, à paraitre. Mais est-ce à dire pour autant que Nostradamus avait dès 1558 – année de l’épitre à Henri II mais non de sa parution - sinon déjà publié ses premières centuries du moins les avait déjà rédigées ou en tout cas planifiées ? Est- ce que ces Significations sont authentiques ? Ce qui est clair, c’est que l’on ne connait pas d’ »interprétation » par Nostradamus de ses Prophéties disposées en centuries. Le scénario posthume nous semble le plus vraisemblable, d’où la pertinence du parallèle avec Morin de Villefranche avec une œuvre en annonçant une autre déjà prête mais dont la parution est reportée. Imagine-t-on un faussaire publiant une édition de l’Astrologia Gallica antidatée pour qu’elle soit parue du vivant de Morin. On notera d’ailleurs qu’il existe deux éditions des Remarques dont la seconde, celle de 1657, est posthume (exemplaire de l’Arsenal) Mais jusqu’où va le parallèle ? En effet, la comparaison entre l’Astrologia Gallica et les Centuries est frappante. Autant le premier ouvrage est construit, cohérent, autant le second est constitué de fragments réunis de façon factice en centuries. Tout se passe comme si Nostradamus avait eu le projet de publier un ouvrage et que cet ouvrage n’a pas été retrouvé si tant est qu’il ait été achevé et qu’à la place, faute de mieux, on ait publié sous le même intitulé un ensemble assez inconsistant. Autrement dit, le titre « prophéties » n’aurait été employé que par référence à un projet resté en plan ou dont on n’aurait pas trouvé de trace sinon dans le cas de quelque « préface à César » . Cela nous fait penser au cas d’Antoine Couillard dont sont annoncés en 1556, à la fin de ses Prophéties une sorte d’inventaire dressé par un parent, à sa mort, ce qui, ipso facto, nous fait considérer cet ouvrage lui-même comme posthume et donc antidaté à l’instar des Prophéties de Nostradamus dont il restitue partiellement la préface à César. On peut d’ailleurs regretter ne pas disposer d’un tel inventaire pour ce que Nostradamus avait laissé derrière lui. Il est remarquable que ceux qui ont étudié les recoupements entre Couillard et la dite Préface n’aient pas remarqué qu’elle comportait des éléments manifestement posthumes (voir notre étude à ce sujet dans les Halbronn’s researches, site propheties.it) On ne peut évidemment exclure que dans les Prophéties de Nostradamus aient pu être inséré ici et là des éléments en prose de la plume de Nostradamus-rendus en vers par d’autres (comme déjà dans le cas des quatrains de ses almanachs annuels) car une chose est certaine, Nostradamus n’a pas laissé de quatrains mais on fait des quatrains à partir de ce qu’il avait laissé. Tout indique, en effet, que Nostradamus entendait être compris « en clair », comme dans le mémoire de son Almanach Nouveau pour 1562 (traduit en italien) . On peut dire d’une certaine façon que certains passages du mémoire de 1561 ont pu être rendus en quatrains dans les éditions des Centuries (cf notre étude sur « macelin » dans les Halbronn’s researches), ce qui pouvait être une façon de faire passer un message censuré. Malheureusement, la forme éclatée du texte en prose rendue en vers en hypothèque singulièrement l’intelligibilité du propos. Cela dit, l’authenticité des Significations de l’éclipse est douteuse et il est improbable que dès 1558, Nostradamus ait envisagé de publier des Prophéties. Si le terme est de son cru, nous pensons qu’il correspond à une période plus tardive lorsque Nostradamus se prenait pour « prophète » et se passionnait pour les éclipses, annonçant en 1561 une naissance redoutable pour 1567, celle du « macelin » né un jour d’éclipse. Or, comme par hasard, le passage en question figure dans les Significations de l’éclipse de 1559. Rappelons que cet ouvrage recopie l’Eclipsium de Leovitius, comme l’ a montré Torné. Le parallèle avec Morin fonctionne jusqu’à un certain point. Il est patent que l’Astrologia Gallica, ouvrage composé en latin, et les Centuries sont les œuvres les plus connues/fameuses de ces deux médecins astrologues français nés sur l’axe rhodanien (à Villefranche/Saône et à Saint Rémy de Provence) au point d’éclipser les autres. Tous deux ont atteint le XXe siècle. Mais la qualité de Nostradamus en tant qu’astrologue s’est estompée au profit de celle de « vaticinateur poète » alors que Morin incarne l’astrologie, quelques années avant l’échéance de 1666 qui est censée, dans la légende dorée de l’astrologie, marquer la fin d’un cycle (édit de Colbert). JHB 01. 06. 13 |
|
196 - Les
Centuries, comme œuvre d’un poète inconnu Par Jacques Halbronn On ne saurait contester l’importance des Centuries par-delà le débat sur la date de leur parution. Il s’agit d’un ensemble qui a suscité un nombre considérable de commentaires, jusqu’à nos jours. Quand bien même, la prose de Nostradamus aurait servi à produire ces centaines de quatrains, cela n’en fait pas l’auteur et c’est à ce versificateur inconnu qu’il convient d’attribuer le mérite d’une telle entreprise. Réduire les Centuries –on laissera de côté ici les textes en prose qui encadrent les dix centuries en deux volets- à leur source nous semble inacceptable, ce serait comme réduire une sculpture au bloc, au matériau, dont elle est issue. Nous pensons ainsi que pour que les centuries aient connu une telle fortune, il aura fallu qu’elles possèdent certaines qualités littéraires remarquables qu’il ne convient pas d’attribuer à Nostradamus. Nous avons déjà relaté de quelle façon les quatrains des almanachs avaient été confectionnés en reprenant de façon assez libre – c’est le moins que l’on puisse dire- la prose assez sèche des publications annuelles de Nostradamus, que de nos jours ne (re)lisent que quelques spécialistes. Alors que le discours de Nostradamus est étayé, immédiatement intelligible, il n’en est rien des quatrains qui en émanent. L’idée que Michel de Nostredame ait pu être l’auteur des quatrains – quels qu’ils soient, ceux des almanachs ou ceux des centuries- nous parait tout à fait improbable. Que Nostradamus en soit considéré comme l’auteur du fait qu’il fournit les données « brutes serait bien abusif. Cela dit, la nature a peur du vide. Dès lors que l’on ne connait pas l’auteur des quatrains, il est tentant, faute de mieux, de se retourner vers Nostradamus mais c’est bien là un pis-aller qui correspond à un syndrome des origines qui peut s’appliquer à nombre de cas. Certes, il est bon de rendre à César ce qui est à César mais ce n’est pas une raison pour télescoper le rôle d’un auteur anonyme qui nous a laissé une telle œuvre en vers dont la postérité s’est emparée. La valeur ajoutée lors du passage de la prose aux vers est considérable, ce qui tend à éclipser la source, d’autant que l’on peut penser que ce versificateur aurait eu, à la longue, autant de succès s’il s’était attelé à versifier d’autres textes d’autres auteurs. Est-ce le même personnage qui aura versifié dès le milieu des années 1550 les almanachs et bien plus tard, dans les années 1580, différentes pièces conservées dans la bibliothèque de Nostradamus ? Nous ne tenterons pas ici d’éclaircir ce point. Rappelons que dans le Janus Gallicus de Jean Aimé de Chavigny (1594), les divers quatrains traduits et (re) traités sont intégrés dans un seul et même support sur lequel articuler des « explications » en prose. On part de la prose (les prédictions datées de Nostradamus)) et l’on revient à de la prose (le commentaire) On est tenté d’attribuer ce mérite à Jean Dorat à la lecture des Bibliothèques de La Croix du Maine et de Du Verdier qui lui attribuent un grand mérite au regard de l’œuvre de Nostradamus (cf. nos études à ce sujet), sans que l’on ait jamais bien su de quoi il retournait. On peut en effet qualifier de « commentaire » poétique de l’œuvre en prose de Nostradamus ces centuries de quatrains. Parmi les publications parues sous le nom de Dorat, se signale le poème consacré à l’Androgyn (Bib. Arsenal) dont le traducteur Jean de Chevigny, qui fut un proche de Nostradamus, cite le quatrain approprié dans son épitre à Larcher (Lyon, Michel Jove, 1570, cf. Benazra, Répertoire Chronologique Nostradamique, Ed La Grande Conjonction-Trédaniel, 1990, pp ; 95-96). Dans la mesure où nombre de ces quatrains se retrouvent chez Antoine Crespin dit Archidamus (cf. nos Documents Inexploités sur le phénomène nostradamus, Ed .Ramkat, 2002), sous une forme renouvelée, que l’on pourrait qualifier de décousue, l’on voit que les auteurs du XVIe siècle s’accordent une certaine liberté de réécriture, qui sublime le plagiat. Dans le cas de l’almanach pour 1562, on rencontre un cas assez singulier puisqu’il apparait que celui-ci aurait été censuré. On ne le connait en français, dans son intégralité, que par un manuscrit conservé mais aussi par une traduction italienne, dont plusieurs versions sont conservées à la BNF. Quant à la version conservée (Bruxelles, Archives du Royaume) de l’almanach en question, elle est considérablement raccourcie et ne comporte pas la partie la plus problématique mais seulement l’épitre au pape (1561). Nous avons montré que certains quatrains des centuries reprenaient cette partie supprimée, notamment ceux qui comportent le mot « macelin ». Dans ce cas, l’on peut penser que certains quatrains visent à rendre peu ou prou ce qui a été interdit, ce macelin se référant à l’annonce par Nostradamus de la naissance d’une sorte d’antéchrist qu’il surnomme Marcelin, macelin (boucher, en italien) étant un jeu de mots de Nostradamus. En conclusion, nous dirons que la fortune du nom de Nostradamus doit énormément au travail accompli en aval et qui aura abouti à un ensemble voué à exercer une certaine fascination sur les esprits, de par ses qualités d’écriture. Ensemble qui, par sa qualité d’évocation, aura inspiré un grand nombre de commentateurs dans le monde, notamment dans le champ prophétique. On peut d’ailleurs se demander si cette fortune des centuries n’aura pas porté ombrage à Nostradamus, après sa mort. Cela pourrait expliquer que l’on ait voulu les antidater et situer leur production dans les années 1550, comme en témoignent les dates des deux épitres « centuriques » censées annoncer les quatrains (ce qui est très probablement une interpolation). Ce faisant, Nostradamus ramasserait la mise. C’est ainsi que le quatrain « macelin » (VIII, 76, pour le plus connu) serait ainsi attesté dès 1558 (qu’il soit ou non paru alors) par l’épitre à Henri II, censée annoncer les trois dernières centuries, donc avant 1561, date de l’almanach pour 1562 et de son appendice prophétique censuré. Autrement dit, l’antidatation des centuries aurait été motivée par la volonté de récupérer les centuries au sein de l’œuvre de Michel de Nostredame. JHB 15.06.13 |
|
197 - Les
centuries comme métamorphose du discours nostradamien Par Jacques Halbronn Nous avons montré dans de précédentes études que les quatrains étaient issus de textes en prose et ne reprenaient jamais des quatrains déjà composés. Cela signifie que l’on peut dater un quatrain, ou du moins déterminer un « terminus » en deça duquel il ne saurait être situé, dès lors que l’on a identifié le texte en prose d’où il est issu. Un cas remarquable est le texte en prose datant de 1561, ayant figuré au sein de l’Almanach Nouveau pour l’An 1562 (cf Benazra, RCN, pp. 52 et seq). On y trouve une forme très particulière, à savoir le nom de Marcelin par lequel Nostradamus entend nommer un personnage qui naitrait en 1567. (cf Reproduction très fidèle d’un manuscrit de M. de Nostradamus dédié à S. S. le Pape Pie IV. (1906). Il signale, au prix d’un jeu de mots, que le caractère de ce Marcelin (un des saints du mois d’avril) ressortirait mieux si l’on supprimait la lettre « R », ce qui donne « macelin », (en Italien, boucher) « Et ne vous veulx rien mettre de l’an 1567 que dans le mois d’Avril naistra un de quelque grand Roy et monarque qui fera sa fin cruelle et sanguinolente mais la ruine de son regne oncques ne fut pire ne plus sanguinaire. On le nommera MARCELLINUS mais on lui ostera de son nom l’R » (Ed 1906, et manuscrit p. 31) C’est ce texte qui sous tend l’occurrence de « Macelin » dans la centurie VIII. VIII, 76 « Plus Macelin que roy en Angleterre » alors que VIII 77 commence par « L’Antéchrist ». Ces deux quatrains dériveraient selon nous des prédictions de Nostradamus pour 1567 qui figuraient dans l’almanach pour 1562. On a un autre quatrain VIII 54 avec « macelin », donc également dans la première centurie du second volet. Il semble d’ailleurs que la forme « marcelin » ait été rétablie dans les éditions troyennes (1605, à en croire le Dictionnaire Nostradamus de Michel Dufresne) Ces observations nous conduisent à conclure que ces quatrains ne peuvent avoir été composés avant 1561, ce qui exclut toute parution datant de 1558 sur la base de la date de l’epitre à Henri II de cette même année. La dite épitre ne peut donc en 1558 introduire le mot « macelin » dans un quatrain de la VIIIe Centurie. On notera le cas des éditions parisiennes ligueuses des « Prophéties » qui traitent de l’an 1561 en leur sous-titre à propos d’une « addition » de 39 articles (sic). Il est possible que l’on ait eu là l’embryon du second volet des Centuries. Dans ce cas le second volet de centuries serait extrait du développement prophétique de 1561 mais à une période bien plus tardive. Rappelons que nous tentons de rétablir la chronologie des faux et non celle d’éditions authentiques parues du vivant de Nostradamus.. Selon nous, la septième centurie aurait été le premier mouvement en direction de ce que l’on connait comme «second volet » ( VIII-X), la date de 1561 correspondant à la parution de l’Almanach Nouveau pour 1562. Cette année 1561 est importante. Nous l’avions déjà rencontrée il y a 20 ans, avec la parution du Cantique Spirituel et consolatif (RHR, 1991). Il est probable que dans l’entreprise centurique, 1561 ait été initialement le moment d’un nouveau développement, ce qui correspond au contenu du manuscrit de l’almanach pour 1562 largement rendu par des imprimés faisant connaitre Nostradamus en langue italienne. Pour nous l’épitre à Pie IV (conservée dans l’imprimé français) et son appendice correspond à un aboutissement de la démarche astroprophétique de Nostradamus qui sera largement occulté et édulcoré par sa transposition en quatrains dans la VIIIe Centurie qui ouvre le second volet. Mais ce second volet est introduit par une épitre datée de 1558 qui vient en quelque sorte se substituer à l’épitre à Pie IV . Or, sous la Ligue, l’année qui est associée à une addition est celle de 1561 : Les Prophéties de M. Michel Nostradamus (…) revues & additionnées par l’autheur pour l’an mil cinq cens soixante & un de trente neuf articles à la dernière centurie . (Paris, 1588/1589) Cette fixation de Nostradamus sur l’an 1567 –à p artir du début des années 1560 – aura fait probléme à la fois parce qu’elle affole les esprits – ce qui trouble l’ordre public (cf. les ordonnances d’Orléans, 1560) et parce qu’elle échoue, au lendemain même de la mort de Nostradamus, au point que l’on peut se demander si les Centuries ne servent pas à brouiller le discours nostradamien et de ce fait à le désenclaver de cette année 1567 que Nostradamus avait imprudemment désignée comme fatale et à laquelle il se tiendra jusqu’à la fin de sa vie. On est avec ce texte dans un prophétisme à très court terme qui se limite aux années 1560 mais qui sera recyclé pour d’autres échéances par les interprètes qui se succéderont. On voit les inconvénients d’un texte par trop précis et définitif qui ne respecte pas le principe de cyclicité et d’éternel retour qui est au cœur de la pensée astrologique. Nostradamus en s’engageant dans cette prédiction pour 1567 se diminue. A contrario, les Centuries lui confèreront, bien malgré lui, une autre stature en éclipsant ce délire antéchristique par trop daté. .On nous objectera que le projet additionnel après la Vie et « dernière » centurie (d’où l’avertissement latin qui clôturé ce cycle de six centuries) se réduisit dans l’immédiat à une centurie VII de quelques dizaines de quatrains. Il faudra en effet attendre quelques années de plus – ce qui est attesté par le Janus Gallicus de 1594 qui comporte des quatrains issus des centuries VIII-X- pour que le second volet se mette en place avec l’épitre à Henri II de 155 et la référence à l’an 1561 sera très largement négligée et remplacée par une date antérieure celle de 1558, Henri II étant mort l’année suivante. C’est donc le choix même du dédicataire qui déterminait le terminus de la date de l’épître, le remplacement du roi de France par le pape. Ce sur quoi nous avons voulu insister, par delà telle ou telle application parmi d’autres possibles, c’est la nécessité pour l’historien de respecter une certaine vraisemblance dans le déroulement des choses. Le quatrain ne devient matriciel que dans un second temps, il est d’abord issu d’un texte en prose. Par ailleurs, le processus centurique de ce fait même correspond à un état tardif de la production nostradamique qu’il convient de qualifier de posthume. Le centurisme est une métamorphose post mortem que subit ainsi Nostradamus sans laquelle le dit Nostradamus serait tombé dans les oubliettes de l’Histoire.. JHB 01 07 13 |
|
Read my blog below, or check it online at: |
|
Note: All reasonable attempts have been
made to contact the copyright We would be grateful if any whom we have been unable to contact would get in touch with us.
|
|
|